cf. diagramme, grille, machine abstraite, programme
bibliographie :
- Françoise Agez, « La carte comme modèle des hypermédias », catalogue de l’exposition Artifices 4, Saint-Denis, 1996.
- Christine Bucci-Glucksmann, L’oeil cartographique de l’art, ed. Galilée, 1996.
illustration :
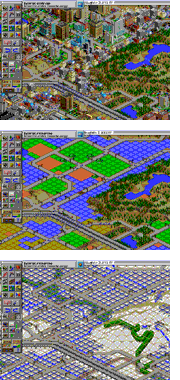
SimCity 2000, Maxis, 1993. Dans beaucoup de jeux informatiques, l’interactivité consiste littéralement en la manipulation d’une carte. Le meilleur exemple dans ce domaine est celui de SimCity 2000, puisque l’interacteur n’a pas d’accès direct à l’action sans médiation de la carte. Dans SimCity 2000 vous êtes maire d’un territoire que nous appellerons Ville X. En tant que maire on peut construire des rues, installer l’électricité dans des quartiers, creuser des canalisations, etc. Mais la véritable action vient des habitants eux-mêmes par rapport à la qualité des infrastructures fournies par la ville. On construit les rues, mais ce sont les habitants qui décident s’ils vont les utiliser. De la même façon, on ne construit pas de maisons, usines ou centres commerciaux dans SimCity 2000, on détermine des parcelles, on fait des répartitions en zones commerciales, industrielles ou résidentielles qui sont remplies en fonction des avantages qu’offrent ces zones. « Diriger » la ville, c’est-à-dire la vie de SimCity, consiste à travailler directement sur le diagramme d’interactions et non pas sur ses représentations elles-mêmes. Ces cartes sont superposées les unes sur les autres, et on les visualise par un procédé de stratifications. Il est possible de faire disparaître à tout moment l’activité de la ville et de ses habitants pour visualiser les canalisations, la répartition des zones, les concentrations de richesse ou de criminalité, ou les infrastructures spécifiques telles que l’eau, l’électricité ou les transports.
illustration :

Doom, ID Software, 1993. Il y a deux modes de visualisation dans Doom, carte 3D et carte 2D. Tous les deux fonctionnent parfaitement bien du point de vue de la navigation, sauf qu’il est plus difficile de se défendre en mode 2D puisque les monstres ne sont pas représentées sur la carte en deux dimensions. Autre particularité de ce jeu d’action : la carte 2D ne se dévoile qu’au fur et à mesure que le jouer avance sur la carte du jeu (cf. proximité). Il s’agit en fait d’une prothèse-mémoire, puisqu’elle se souvient, à la place du joueur, de la topologie des endroits qu’il a visité. Mais elle propose également un récit au joueur, une carte de son parcours. En regardant la carte 2D, je vois les endroits que j’ai déjà visités et les endroits où le labyrinthe reste obscurci, dans l’inconnu. La carte trace mon trajet, elle m’inscrit dans le « territoire ». La carte en deux dimensions est une projection de la carte 3D, c’est-à-dire qu’elle montre à la simulation en trois dimensions qu’elle est, elle aussi, carte et diagramme d’interactivité, aussi bien que « réalité virtuelle ». La carte est également un mode de visualisation du fonctionnement du programme, similaire aux produits de catalogues interactifs, puisque la carte sert aussi bien à orienter l’interacteur qu’à orienter le programme. Car, en fait, le programme se sert lui aussi de la carte pour situer le joueur, les objets, le territoire et les actions du jeu. On affiche pour l’interacteur un dispositif déjà inclus dans le programme, celui qui a permis de créer le « floor-plan » de l’image 3d, à partir duquel on a échafaudé en temps réel les structures spatiales du labyrinthe. C’est dans ce sens que, dans Doom, l’image 3D — celle qui a l’air réelle, spatiale, non-schématique — est déjà en quelque sorte une carte : celle qui permet de lire celle qui n’est accessible qu’au programme.
illustration :
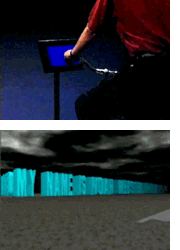
Legible City, installation interactive, Jeffrey Shaw, 1989-1991. Comme dans le dispositif de simulation 3D de Doom, Legible City construit également un parcours 3D à partir d’une carte 2D. Mais cette fois-ci le dispositif est la clé de son expérience. Cette installation — qui permet à un interacteur de monter sur un vélo qui fait du sur-place et de se balader virtuellement dans les villes de Manhattan, Amsterdam ou Karlsruhe — ne cherche pas à remplacer la carte par une image qui simule la réalité, du tourisme virtuel. Cette fois-ci, l’image reste plus près de la carte : au lieu de simuler des bâtiments à partir d’une carte 2D des rues de la ville, Jeffrey Shaw érige des phrases, qui, elles, permettent à l’interacteur de saisir sa topologie. Ici référence et représentation rejoignent la seule figure de la simulation. La carte facilite l’occupation de ce double positionnement, car elle construit une place entre les deux et à part : 1. elle est faite de données, c’est-à-dire des plans spatiaux ou diagrammatiques de la ville, construits par un « plan-transfert » (Bucci-Glucksmann) ; 2. elle est accédée dans l’interactivité à partir de « lignes » de codes, de lettres et de mots de la programmation qui reconstituent la carte de toutes pièces, comme des indications de deuxième degré sur cette chose, une sorte de deuxième carte à partir de la première. L’interactivité consiste à parcourir ces deux plans d’abstraction de la ville et à créer une projection, une actualisation, c’est-à-dire un parcours personnel de territorialisation presque affectif de cette carte. Mais, on est nullement dans l’histoire platonicienne de deuxième ou de troisième copie du réel. On est dans une image de l’effort qui, comme la table schizophrénique (cf. effort), construit une véritable expérience de la ville, un parcours et une topologie tout à fait effectifs en rapport constant avec le réel, mais dans un état virtuel où mémoire et désir n’ont plus besoin de passer par la « réalité » pour vérifier l’actualité de l’espace. C’est comme une histoire bien connue : « vous prenez la rue devant vous, vous arriverez devant un bâtiment ancien avec une grande porte bleue qui autrefois était un cinéma mais qui maintenant est rempli de bureaux vides. Devant cette porte vous tournerez à droite, et puis après le deuxième feu vous verrez un restaurant chinois et une boulangerie à côté d’un petit parc… » Car au fond, quand quelqu’un vous donne des directions dans une ville inconnue fait-il autre chose que ce que Shaw a condensé ici dans un seul geste informatique ? Dans ce geste de l’indication ou de rapport déictique au réel, on construit une nouvelle ville, une ville plus affective, traversée par des événements personnels, remplie de signes-mémoire de lieux visités, de rencontres inattendues, et de trajets depuis trop longtemps tracés. Cet effort d’urbanisation affective ressemble étrangement à celui de l’effort d’urbanisation interactive de Jeffrey Shaw parce qu’il met en avant l’importance du trajet dans notre expérience de la carte, et la nécessité d’agir au moins dans l’effort, c’est-à-dire inter-agir, pour occuper le territoire.
